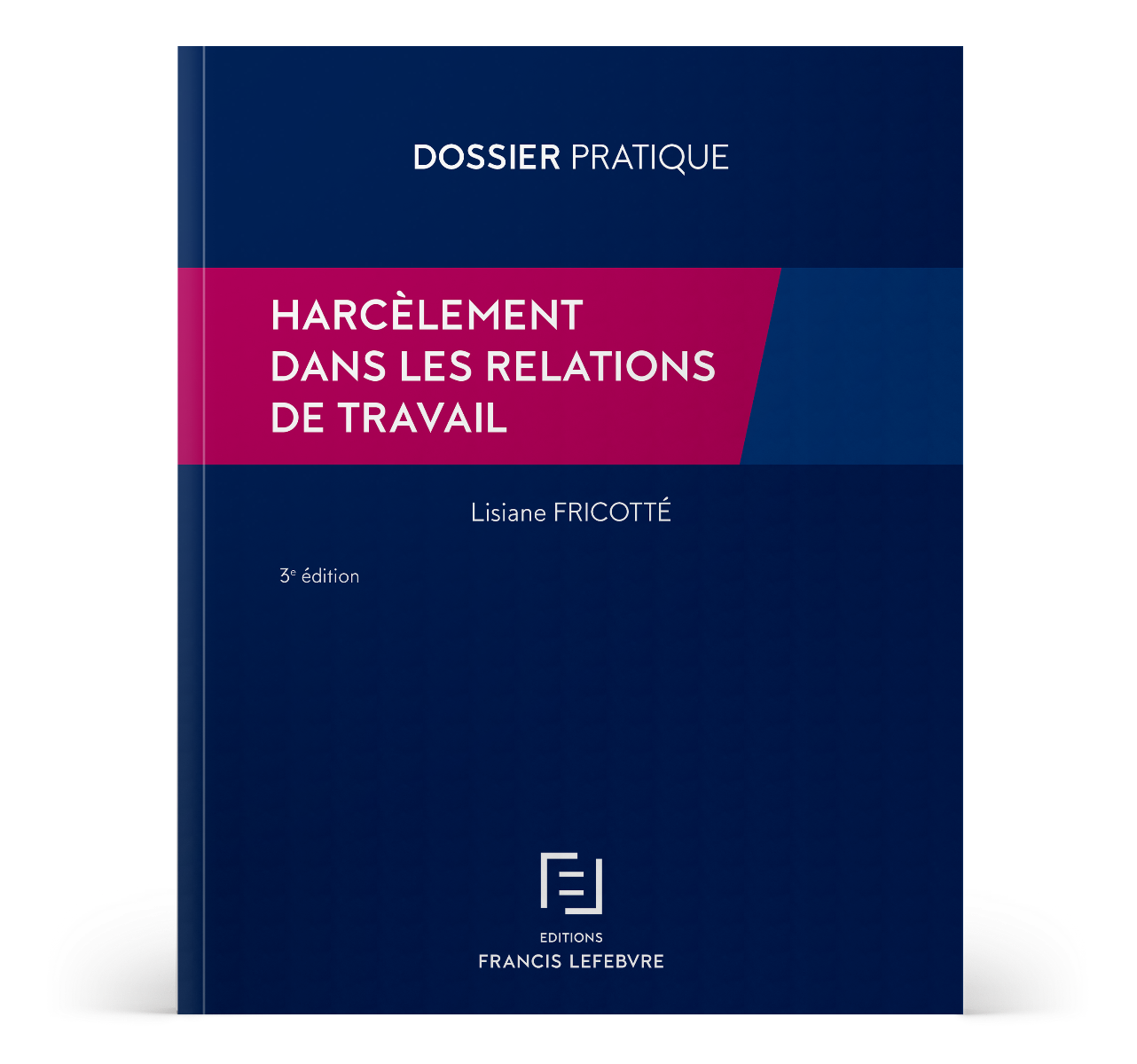CA Rouen 13-11-2024 n° 23/02493, Assoc. APF France Handicap c/ D.
Un salarié fait une tentative de suicide sur son lieu de travail
En l’espèce, un salarié est placé en arrêt maladie pendant plus de deux mois pour syndrome dépressif à la suite du décès d’un proche. Lors de la visite de reprise, le médecin du travail mentionne dans son dossier médical qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique pour troubles bipolaires et schizophrénie et le déclare apte à la reprise à son poste d’agent de tri avec réserves (à savoir, éviter la position debout et le port de charges supérieures à 10 kg). Il n’a pas revu ultérieurement l’intéressé.
A noter :
Après une absence pour maladie non professionnelle d'au moins 60 jours, le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise pratiqué par le médecin du travail (C. trav. art. R 4624-31, 4°).
Puis, 11 mois après la visite de reprise, en pleine crise sanitaire, le salarié entre en conflit avec son directeur d’établissement à propos des consignes de sécurité relatives à la Covid-19 et devient menaçant. Le lendemain, il ingère des médicaments en vue de se suicider mais est secouru par une collègue.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) réalise une enquête administrative. Celle-ci démontre que la tentative de suicide procède du stress que le salarié a subi et a exprimé pendant la période de confinement et à son retour au travail. La CPAM qualifie cet incident d’accident du travail.
Le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur devant le conseil de prud’hommes. Sa demande est accueillie par les juges. L’employeur se retourne alors contre le médecin du travail et le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) qui l’emploie pour être indemnisé du préjudice causé, selon lui, par leur carence.
L’employeur reproche au médecin du travail de ne pas l’avoir conseillé au sujet de la gestion du poste de travail de l’intéressé alors qu’il savait que ce dernier souffrait de bipolarité et de schizophrénie et devait forcément avoir conscience, selon lui, que ces pathologies pouvaient entraîner des répercussions sur son comportement au travail. Pour lui, le médecin du travail aurait dû enfreindre la règle du secret professionnel : en ne le faisant pas, il ne lui a pas permis de remplir son obligation de sécurité à l’égard de son personnel, mis en danger par le salarié victime de troubles mentaux.
L’employeur sollicite, devant le tribunal judiciaire, le paiement de dommages-intérêts, à titre principal, par le médecin du travail ou, à titre subsidiaire, par le SPSTI, en tant qu’employeur du médecin du travail, au titre de la responsabilité du commettant pour la faute commise par son préposé (C. civ. art. 1242). Le tribunal judiciaire le déboute de ses demandes, au motif qu’il n’existe aucun rapport entre les interventions et éventuelles prescriptions du médecin du travail et la tentative de suicide. L’employeur interjette appel.
La responsabilité du médecin du travail n’est pas engagée…
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif (C. trav. art. L 4622-3). Il doit conseiller l’employeur des salariés dont il assure le suivi médical sur les dispositions et mesures à prendre afin notamment d'éviter ou de diminuer les risques professionnels (C. trav. art. L 4622-2). Dans l’exercice de cette mission, il est tenu à une obligation de respect du secret professionnel. Le secret couvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris (CSP art. R 4127-4).
Le médecin du travail, comme tout salarié, ne peut engager sa responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers que s’il excède les limites de la mission qui lui est impartie par son employeur (en ce sens, Cass. ass. plén. 25-2-2000 n° 97-17.378 P ; Cass. crim. 4-9-2018 n° 17-82.297 F-D) ou bien s’il commet une infraction pénale ou une faute intentionnelle (Cass. soc. 30-6-2015 n° 13-28.201 FS-PB ; Cass. soc. 26-1-2022 n° 20-10.610 FS-B). Tant qu’il ne franchit pas ces limites, le médecin du travail bénéficie d’une immunité légale en application de l’article 1242, alinéa 5 du Code civil : c’est alors son employeur qui est responsable – c’est-à-dire l’entreprise elle-même, dans le cadre d’un service de santé autonome, ou le SPSTI, dans le cadre d’un service interentreprises.
A noter :
La Cour de cassation a rappelé ces principes à propos de faits de harcèlement moral ou de violation du secret professionnel reprochés à un médecin du travail (Cass. soc. 30-6-2015 n° 13-28.201 FS-PB et Cass. soc. 26-1-2022 n° 20-10.610 FS-B précités).
En l’espèce, pour la cour d’appel, l’employeur ne parvient pas à démontrer que le médecin du travail salarié a agi en dehors des limites de la mission qui lui était impartie par le SPSTI ni qu’il a commis une infraction pénale ou une faute intentionnelle. Par conséquent, juge-t-elle, le médecin du travail n'a pas engagé sa responsabilité personnelle, quelle que soit l'indépendance dont il bénéficie dans l'exercice de sa mission.
… ni celle du service de prévention et de santé au travail interentreprises
La responsabilité du médecin du travail ayant été écartée, place à la recherche de la responsabilité civile du commettant (le SPSTI) à raison des dommages causés par son préposé (le médecin du travail) dans l’exercice de ses fonctions (C. civ. art. 1242, al. 5).
Pour la cour d’appel, aucun élément médical physique ou psychique lors de l’examen médical n'était de nature à déterminer le médecin du travail à prévenir l'employeur d'un risque pour la santé et la sécurité du salarié et de son entourage professionnel, ni à le conseiller sur l'aptitude professionnelle de son salarié au regard de sa santé physique et psychique, ni encore à faire appel à un autre praticien.
Elle en déduit qu’il ne peut pas être reproché au médecin du travail de ne pas avoir anticipé la tentative de suicide du salarié et l'expression de menaces de la part de celui-ci à l'encontre de son directeur d'établissement qui ont eu lieu 11 mois après la réalisation de l’examen médical.
La cour d’appel prend soin de préciser que le médecin du travail n’avait donc pas à enfreindre le secret médical auquel il est tenu. Au vu de ces éléments, la responsabilité du SPSTI est écartée.
A notre avis :
La solution des juges du fond est ici notamment justifiée par le fait qu’une longue période (11 mois) sépare l’examen médical du salarié et le passage à l’acte de ce dernier : au moment où le médecin du travail a examiné le salarié, aucun élément médical n’aurait justifié que le médecin du travail prenne des mesures en raison de sa dangerosité potentielle.
Par ailleurs, le respect du secret médical, qui vise à assurer la confiance dans les échanges entre le salarié et le médecin du travail, interdit à ce dernier de communiquer des éléments du dossier médical à l’employeur (voir en ce sens, Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-40.209 FS-P). Enfreindre cette règle pourrait exposer le médecin du travail à des sanctions devant le Conseil national de l’Ordre des médecins.
Enfin, le médecin du travail et le SPSTI arguaient en défense que, l’état de stress exprimé par le salarié étant à l’origine de la tentative de suicide, l’employeur de ce dernier n’a pas fait preuve de l’écoute et de la bienveillance nécessaires. Tenu à une obligation de sécurité, il aurait dû prendre contact avec le médecin du travail s’il nourrissait des soupçons sur l’état de santé mentale du salarié. C’est ce qu’on conseillera de faire à l’employeur se retrouvant confronté à une telle situation.
Retrouvez toute l'actualité sociale décryptée et commentée par la rédaction Lefebvre Dalloz dans votre Navis Social.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.