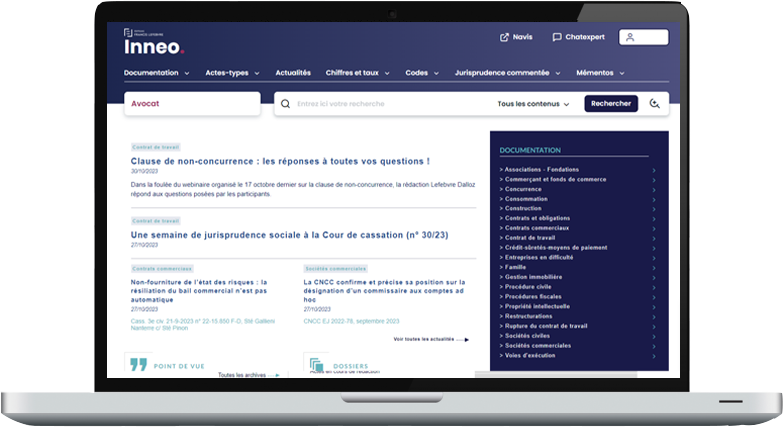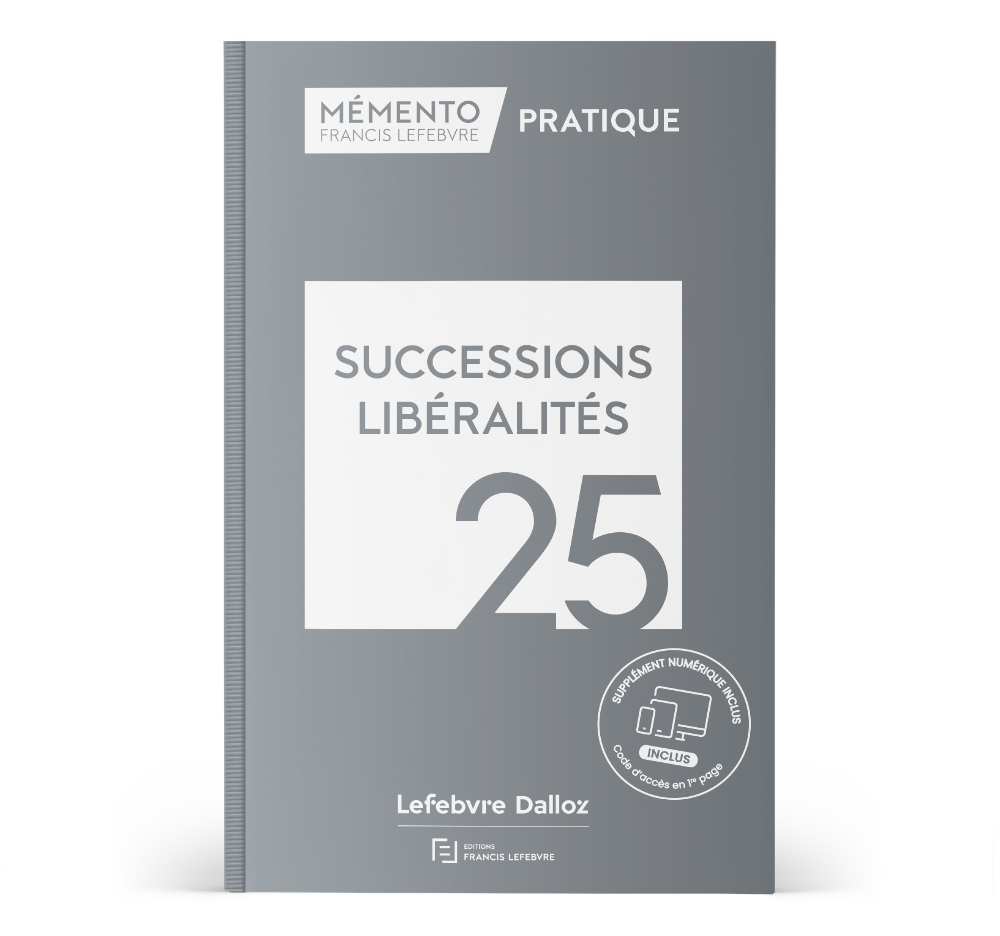Des époux séparés de biens divorcent. Un litige les oppose lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. La cour d’appel fixe à 267 241 € la créance due par l’épouse à son ex pour les travaux qu’il a réalisés dans le logement familial. Son raisonnement est le suivant : l’ex-mari a surcontribué aux charges du mariage en finançant plus que sa part dans les travaux du logement, soit 486 359 € au lieu de 219 118 € représentant le tiers du montant total des travaux (657 354 / 3). La créance due correspond à la différence. L’ex-femme conteste la décision, les juges du fond n’ayant pas recherché si l’ex-mari avait par ailleurs contribué à hauteur de ses facultés pour le reste des dépenses quotidiennes du ménage.
La Cour de cassation accueille le pourvoi. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives (C. civ. art. 214). Après avoir retenu que l’ex-épouse avait financé l’intégralité des dépenses courantes du ménage, de sorte que l’excès contributif ne pouvait être caractérisé en considération exclusive du financement des travaux, la cour d’appel a violé l’article 214 du Code civil.
A noter :
L’arrêt offre une illustration intéressante du mode de détermination de la surcontribution d’un époux séparé de biens aux charges du mariage, justifiant une créance à son profit. À défaut de précision différente dans le contrat de mariage, le principe est que les charges du mariage doivent être assumées par les époux « à proportion de leurs facultés respectives » (C. civ. art. 214). Ainsi, dans un ménage où le salaire de la femme correspond à la moitié de celui du mari, ce dernier doit contribuer aux charges du mariage à hauteur de 2/3 et son épouse 1/3 ; ce n’est que si l’époux y participe au-delà des 2/3 qu’une créance sera envisageable en cas de divorce. Dès lors, pour déterminer cet excès contributif, le juge doit :
non seulement évaluer les facultés respectives de chaque époux, ce qui le conduit à prendre en considération les ressources de chacun des époux : gains et salaires, revenus des biens propres (N. Peterka et Q. Guigué-Schielé : Régimes matrimoniaux, coll. Hypercours, Dalloz 8e éd. 2024, n° 199). Et ce, en tenant compte des charges supportées par l'intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires (Cass. 1e civ. 15-11-1989 no 88-13.259 : Bull. civ. I no 351) ;
mais aussi, comme le rappelle utilement cet arrêt, tenir compte des dépenses effectuées par chaque époux au titre de l’ensemble des charges du mariage. Les juges ne peuvent se borner à examiner une seule catégorie de celles-ci. En l’espèce, le mari avait certes financé les travaux immobiliers bien au-delà de sa part contributive. Mais le raisonnement ne pouvait pas s’arrêter là dès lors que l’épouse avait, elle, payé toutes les dépenses courantes du ménage. Ce qui impliquait une sous-contribution du mari à ce titre, dont les juges du fond auraient dû tenir compte dans le calcul de sa créance.